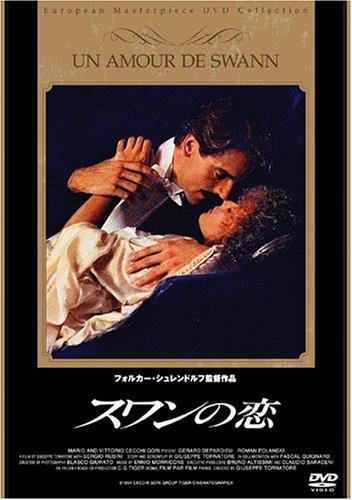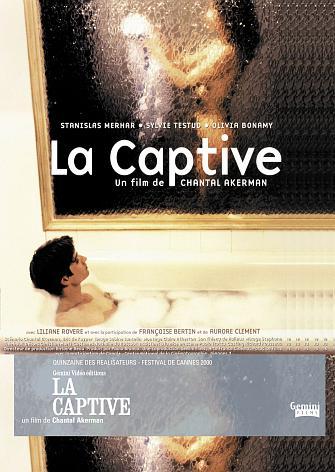CINE-CLUB
→ Blog
Juin
2006, thème du mois : Adaptation filmique d'A la recherche du
temps perdu
Mercredi
7 juin, 16 heures 40, salle 21C
Un
Amour de Swann de
Volker Schlöndorff (1984), avec Jeremy Irons, Ornella Muti, 110 minutes, couleur, version
française sous-titrée en japonais.
En 1962, Nicole Stéphane avait acheté les droits d' A la recherche du temps perdu, de Proust. La productrice pensait à Visconti pour une adaptation qui ne se fit pas. Non plus qu'un scénario de Harold Pinter pour Losey. Des cinéastes français, contactés, hésitèrent, puis déclinèrent. Finalement, Nicole Stéphane eut l'idée de tourner seulement Un amour de Swann, ce que fit Volker Schlöndorff, sur un scénario de Peter Brook, Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne. Une avalanche d'articles savants et de commentaires souvent aigrelets s'ensuivit. Mais le film existe et il est très beau dans son parti pris d'illustration socio-psychologique. Toute la passion que Swann le dandy éprouve pour Odette, cocotte vulgaire et « lancée », est condensée en un jour et une nuit. Schlöndorff a filmé une chronique mondaine (et demi-mondaine) des années 1880, et toutes les sensations qu'éprouve Swann au cours d'un itinéraire tourmenté. Quelques détails ont été pris ailleurs. Et, quinze ans plus tard, dans un épilogue crépusculaire aux Tuileries, le bourgeois juif achève son destin. Jeremy Irons (doublé par Pierre Arditi), Alain Delon (admirable en Charlus), Ornella Muti, Fanny Ardant, Marie-Christine Barrault, Jean-François Balmer, Jean-Louis Richard, donnent une juste vision de l'univers de Proust, aujourd'hui relancée par le film de Raoul Ruiz.
Jacques Siclier
(Le Monde)
Mercredi
14 juin, 16 heures 40, salle 21C
Le
Temps retrouvé de
Raoul Ruiz (1999), avec Catherine
Deneuve, Emmanuelle Béart, Vincent Perez,
158 minutes, couleur, version
française sous-titrée en japonais.
Comment
réussit-on une gageure cinématographique ? Par la combinaison harmonieuse d'un
grand nombre de réussites, plus... quelque chose. Il y a du pari stupide dans
le projet d'adapter Proust à l'écran. Dès les premières séquences, on songe
pourtant qu'il se pourrait que Raoul Ruiz ait trouvé la solution miracle. Rien
de très original au premier abord, c'est d'ailleurs ce qui plaît dans la
reconstitution scrupuleuse des derniers jours de l'écrivain : la simplicité un
peu vieillotte du procédé qui consiste à lancer la machine à remonter le
temps avec une collection de photos où figurent les principaux personnages, et
l'acteur qui joue Proust énonçant leurs noms tandis qu'on entend leurs voix
qui s'élèvent et se mêlent. Là est le premier élément de la réussite du
film : ne pas prendre de haut le spectateur au nom du caractère monumental de l'œuvre
adaptée, ne pas chercher à faire Proust avec la caméra.
Nous voici donc partis pour un voyage dans le passé. On circulera librement d'une époque à l'autre dans ce tournant du siècle où la bonne société voit se modifier les rapports de forces entre ses composantes - aristocrates vrais ou faux, banquiers, commerçants enrichis, coquettes et cocottes -, tandis que se dessine le signal de temps nouveaux, la boucherie de 14. Un enfant, qui est Marcel Proust, tient une lanterne magique, voilà pour l'insondable débat autour de la question de l'auteur et de son identité ou non avec le narrateur de La Recherche. Le narrateur, ici, c'est naturellement Raoul Ruiz, celui qui fait le film. Gardiens du temple proustien et vestales du petit Marcel, passez votre chemin : quiconque se cramponnera à son souvenir trop précis du texte perdra tout, le film et le bonheur qui en émane. Car là est bien le miracle de ce film -fleuve, a priori menacé par l'académisme, la pompe antiquaire et le star system. C'est un film qui rend heureux.
Jean
Michel Frodon
(Le Monde)
Mercredi
21 juin, 16 heures 40, salle 21C
La
Captive de
Chantal Akerman
(2000), avec Sylvie
Testud, Stanislas Merhar, Olivia Bonamy,
108 minutes, couleur, version
française sans sous-titre.
Des images en super-huit cahotantes et insouciantes, quelques jeunes filles s'ébattant sur une plage, l'une d'elles fixe la caméra, murmure quelque chose. Le début du nouveau film de Chantal Akerman s'ouvre sur la projection d'un film amateur de vacances, avec tout ce que cela peut signifier : la trace d'un passé suffisamment heureux pour avoir été préservé sur pellicule. Mais cette adaptation - très libre - de La Prisonnière, de Proust, s'attachera moins à la réflexion sur le temps qu'à l'exploration d'un autre thème proustien majeur, la jalousie.
La
Captive installe immédiatement une impalpable ambiance de doute, de soupçon,
d'incertitude. Une jeune femme traverse la place Vendôme et monte dans une
voiture décapotable. Un jeune homme la suit. Drame de la jalousie, polar ? Que
signifie cette étrange filature digne par sa durée d'un remake moderniste de
Vertigo ? Elle, c'est Ariane, lui, c'est Simon. Ils logent dans un appartement
ancien qui semble en rénovation constante et qu'ils partagent avec la grand-mère
de Simon. Ils ne dorment pas dans la même pièce, mais elle le rejoint parfois
dans son lit. Lorsqu'il travaille, elle part se promener ou suivre des cours de
chant, immanquablement accompagnée de son amie Andrée. Elle a toujours une réponse
aux questions qu'il lui pose sur son emploi du temps.
Jean-François
Rauger (Le Monde)
Entrée libre.
Pour plus d’information, s’adresser à Juro NAKAO (poste 7807).
http://taweb.aichi-u.ac.jp/futubun/